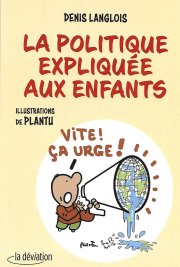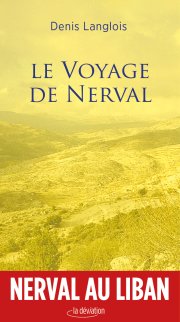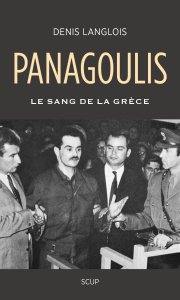- AGENDA
Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2024, Denis Langlois vous attend au SALON DU LIVRE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, salle des 4 Saisons, avenue de l’Hippodrome, sur le stand de la Librairie Le Furet du Nord.

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2024, Denis Langlois sera au SALON DU LIVRE "Marque-page", à CÉBAZAT (Puy-de-Dôme), Domaine de la Prade, 46 route de Gerzat, près de Clermont-Ferrand, sur le stand des Editions La Déviation.

.
Le samedi 28 septembre 2024, à 15 heures, à MONNERVILLE (Essonne), CONFÉRENCE-DÉBAT "La Mort du babouin de Monnerville".
Le 22 août 2024, parution d’un nouveau livre aux éditions La Déviation : La Cavale du babouin
En 2022 : Parution de La Politique expliquée aux enfants de Denis Langlois, illustrée par Plantu. (Editions La Déviation)
Édition spéciale 1983-2022.
.
2021. "Le Voyage de Nerval" (Gérard de Nerval au Liban), récit de Denis Langlois, paraît aux éditions de La Déviation.
.

Paru en 2020 le livre "Pour en finir avec l’affaire Seznec" (La Différence) de Denis Langlois (avec un cahier-photos de 16 pages) sera bientôt à nouveau disponible en librairie.
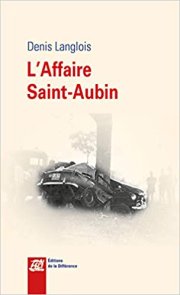
2019
Les Éditions de La Différence publient "L’Affaire Saint-Aubin" de Denis Langlois, avec un cahier-photos de 16 pages.
2018, les éditions SCUP-La Déviation publient une nouvelle édition complétée et illustrée de "Panagoulis, le sang de la Grèce" de Denis Langlois.
.
ARCHIVES MILITANTES.
Nouvelles rubriques sur le site :
*La Ligue des droits de l’homme (1967-1971).
*La Fédération internationale des droits de l’homme (1968-1970).
*Les luttes militantes pour l’autodétermination du Pays Basque (1984-1997).
Lisez jeunesse (15 avril 2012). Philippe Geneste
PACIFISME.
Denis Langlois signe là un roman passionnant où l’actualité nourrit la vie des personnages, où la fiction transporte du Liban la problématique des réfugiés.
Le récit est écrit à la première personne. Et il est vrai qu’il se présente comme une autobiographie parcellaire, le narrateur évoquant la mort de son père. Mais par la suite, on entre dans une fiction qui va mener le personnage principal au Liban à la demande d’une mère qui recherche son fils. Là s’arrête l’autobiographie et s’ouvre un récit d’enquête. Le héros du livre est donc un absent, Elia Kassem qui a disparu au cours de la guerre du Liban lors des affrontements entre Druzes et chrétiens au début des années 1980. Kassem était un pacifiste convaincu, enseignant. Il refusait le port des armes et pour cela a subi la haine du camp chrétien de son village :
« Les hommes (…) qui racontaient leurs exploits. Kassem ne participait pas à la discussion. Il n’en avait pas envie. Chaque fois qu’il ouvrait la bouche, quelqu’un disait : “Ah ! toi, ça va, le pacifiste ! ça va, le dégonflé !” » (p.69).
Kassem pensait, lui, que
« la vengeance ne servait à rien, que c’était un sentiment négatif qui ne pouvait pas aider un être humain à se reconstruire. Les vivants ne devaient pas être au service des morts » (p.55).
Sa famille a été massacrée, et il traîne une culpabilité qui fait l’objet de l’intrigue sans que s’en aperçoive immédiatement le lecteur. Kassem a été déplacé, puis on a perdu sa trace alors que sa mère s’exilait en France :
« Est-il d’ailleurs indispensable pour un déplacé de se mouvoir ? La question est stupide, mais pas si stupide que cela. On peut être déplacé dans sa tête. Ne pas se sentir bien où l’on se trouve, ne plus savoir quelle est sa véritable place. Un déplacé, c’est quelqu’un qui a perdu sa place. Quelqu’un qui cherche à retourner à la case départ, mais on ne retrouve jamais la case départ dans l’état où on l’a quittée. Non seulement on ne reconnaît pas les lieux, mais on ne se reconnaît pas soi-même. Il faudrait pouvoir emporter sa case départ sur le dos, comme un sac de camping, mais par définition la case départ ne part pas. Elle reste là, en regardant le dos des partants. Quand ils reviennent, elle ne les reconnaît pas, elle ne les a jamais vus. Personne d’ailleurs ne les reconnaît. On ne sait pas quel nom leur donner. Les retournants ? Les revenants ? » (pp.237/238).
Le livre nous parle donc de l’impossibilité de revivre lorsque le regard ne se tourne que vers le passé, vers les paysages abandonnés, les êtres chers perdus. Le livre interroge cette part sclérosante de la mémoire, sa force de pétrification et il en fouille les ressorts. Ce figement est une fuite immobile de soi-même, de ses illusions :
« Là, il n’y a pas de remède. Je peux partir aussi loin que je veux, je me retrouverai toujours en travers du chemin. Je m’emmène dans mes bagages. Quand je les déballe, je constate que je suis là. Je me quitte, mais au débarcadère du bateau, au pied de la passerelle de l’avion, la première personne qui m’accueille, c’est moi ». (p.89/90)
« Bref, aucune solution. La fuite ne sert à rien. Je peux tourner la page, mais non déchirer le livre ». (p.90)
Ce qui convainc, c’est le non machiavélisme du regard du narrateur. Ainsi, cette femme qui a connu Kassem :
« Les non-dits, c’est le plus lourd à porter. Non seulement pour les victimes, mais pour les coupables. Ils croisent dans la rue ceux dont ils ont massacré la famille ou pillé la maison. Ils ont peur. Ils ont besoin d’un pardon. Les autres, ceux qui se sont comportés humainement, ont besoin de reconnaissance. Le silence fait que tout le monde est solidaire, et l’on oublie que de nombreux Druzes ou chrétiens n’étaient pas d’accord. Certains ont même risqué leur vie pour s’opposer aux massacres. En général, le héros, c’est le guerrier qui triomphe de l’ennemi. Il faut réhabiliter, ou plutôt habiliter, celui qui sauve la vie de ceux que l’on considère à tort comme des ennemis. » (p.138).
Cette posture peut, parfois, irriter quand elle flirte avec la neutralité. Mais ce que montre le roman, c’est la perversité de la guerre :
« Beaucoup s’en mettaient plein les poches. Les taxes, les amendes, les péages, les dessous-de-table. La guerre c’est aussi du commerce ! Lui, Elias, il ne touchait à rien » (p.101).
Et de ce fait, ce que montre aussi Le Déplacé, c’est que l’attitude du refus est un engagement. :
« C’est quoi la bravoure ? C’est quoi la peur ? Elias, lui, il ne voulait pas se battre, il ne voulait pas prendre parti dans la boucherie. Mais en dehors de cela, il ne manquait pas de courage » (p. 100).
On pense alors, dans ces pages-ci, au grand roman du romancier catalan Ludovic Massé, Le Refus, écrit en mars 1945 et qui tient « dans cette affirmation du personnage principal : “qu’en une telle époque, il n’y avait de générosité, de dignité et de liberté que dans le refus” » (1). Le roman de Denis Langlois n’épouse pas totalement le ton du roman de Ludovic Massé. Elias Kassem traîne une blessure de tristesse purulente de lâcheté, non pas face à la guerre, mais face à un drame intime né de la guerre, où s’enracine ce sentiment de culpabilité qui pèse sur la narration au fur et à mesure que l’on avance dans le récit. La fin du livre présente une allégorie : c’est une petite fille aux yeux mauves assise en haut de l’escalier de la maison d’Elias Kassem où se rend le narrateur. La petite fille tend au narrateur une enveloppe blanche laissée pour lui par Elias Kassem qui n’est pas là et elle lui tend aussi « un minuscule fruit rouge de grenadier ». N’est-ce pas une promesse de rencontrer les vivants, le signe d’aller à la rencontre du vivant, de soi vivant, ce qui ramène à l’interrogation du tout début du livre.
Philippe GENESTE
PACIFISME.
Denis Langlois signe là un roman passionnant où l’actualité nourrit la vie des personnages, où la fiction transporte du Liban la problématique des réfugiés.
Le récit est écrit à la première personne. Et il est vrai qu’il se présente comme une autobiographie parcellaire, le narrateur évoquant la mort de son père. Mais par la suite, on entre dans une fiction qui va mener le personnage principal au Liban à la demande d’une mère qui recherche son fils. Là s’arrête l’autobiographie et s’ouvre un récit d’enquête. Le héros du livre est donc un absent, Elia Kassem qui a disparu au cours de la guerre du Liban lors des affrontements entre Druzes et chrétiens au début des années 1980. Kassem était un pacifiste convaincu, enseignant. Il refusait le port des armes et pour cela a subi la haine du camp chrétien de son village :
« Les hommes (…) qui racontaient leurs exploits. Kassem ne participait pas à la discussion. Il n’en avait pas envie. Chaque fois qu’il ouvrait la bouche, quelqu’un disait : “Ah ! toi, ça va, le pacifiste ! ça va, le dégonflé !” » (p.69).
Kassem pensait, lui, que
« la vengeance ne servait à rien, que c’était un sentiment négatif qui ne pouvait pas aider un être humain à se reconstruire. Les vivants ne devaient pas être au service des morts » (p.55).
Sa famille a été massacrée, et il traîne une culpabilité qui fait l’objet de l’intrigue sans que s’en aperçoive immédiatement le lecteur. Kassem a été déplacé, puis on a perdu sa trace alors que sa mère s’exilait en France :
« Est-il d’ailleurs indispensable pour un déplacé de se mouvoir ? La question est stupide, mais pas si stupide que cela. On peut être déplacé dans sa tête. Ne pas se sentir bien où l’on se trouve, ne plus savoir quelle est sa véritable place. Un déplacé, c’est quelqu’un qui a perdu sa place. Quelqu’un qui cherche à retourner à la case départ, mais on ne retrouve jamais la case départ dans l’état où on l’a quittée. Non seulement on ne reconnaît pas les lieux, mais on ne se reconnaît pas soi-même. Il faudrait pouvoir emporter sa case départ sur le dos, comme un sac de camping, mais par définition la case départ ne part pas. Elle reste là, en regardant le dos des partants. Quand ils reviennent, elle ne les reconnaît pas, elle ne les a jamais vus. Personne d’ailleurs ne les reconnaît. On ne sait pas quel nom leur donner. Les retournants ? Les revenants ? » (pp.237/238).
Le livre nous parle donc de l’impossibilité de revivre lorsque le regard ne se tourne que vers le passé, vers les paysages abandonnés, les êtres chers perdus. Le livre interroge cette part sclérosante de la mémoire, sa force de pétrification et il en fouille les ressorts. Ce figement est une fuite immobile de soi-même, de ses illusions :
« Là, il n’y a pas de remède. Je peux partir aussi loin que je veux, je me retrouverai toujours en travers du chemin. Je m’emmène dans mes bagages. Quand je les déballe, je constate que je suis là. Je me quitte, mais au débarcadère du bateau, au pied de la passerelle de l’avion, la première personne qui m’accueille, c’est moi ». (p.89/90)
« Bref, aucune solution. La fuite ne sert à rien. Je peux tourner la page, mais non déchirer le livre ». (p.90)
Ce qui convainc, c’est le non machiavélisme du regard du narrateur. Ainsi, cette femme qui a connu Kassem :
« Les non-dits, c’est le plus lourd à porter. Non seulement pour les victimes, mais pour les coupables. Ils croisent dans la rue ceux dont ils ont massacré la famille ou pillé la maison. Ils ont peur. Ils ont besoin d’un pardon. Les autres, ceux qui se sont comportés humainement, ont besoin de reconnaissance. Le silence fait que tout le monde est solidaire, et l’on oublie que de nombreux Druzes ou chrétiens n’étaient pas d’accord. Certains ont même risqué leur vie pour s’opposer aux massacres. En général, le héros, c’est le guerrier qui triomphe de l’ennemi. Il faut réhabiliter, ou plutôt habiliter, celui qui sauve la vie de ceux que l’on considère à tort comme des ennemis. » (p.138).
Cette posture peut, parfois, irriter quand elle flirte avec la neutralité. Mais ce que montre le roman, c’est la perversité de la guerre :
« Beaucoup s’en mettaient plein les poches. Les taxes, les amendes, les péages, les dessous-de-table. La guerre c’est aussi du commerce ! Lui, Elias, il ne touchait à rien » (p.101).
Et de ce fait, ce que montre aussi Le Déplacé, c’est que l’attitude du refus est un engagement. :
« C’est quoi la bravoure ? C’est quoi la peur ? Elias, lui, il ne voulait pas se battre, il ne voulait pas prendre parti dans la boucherie. Mais en dehors de cela, il ne manquait pas de courage » (p. 100).
On pense alors, dans ces pages-ci, au grand roman du romancier catalan Ludovic Massé, Le Refus, écrit en mars 1945 et qui tient « dans cette affirmation du personnage principal : “qu’en une telle époque, il n’y avait de générosité, de dignité et de liberté que dans le refus” » (1). Le roman de Denis Langlois n’épouse pas totalement le ton du roman de Ludovic Massé. Elias Kassem traîne une blessure de tristesse purulente de lâcheté, non pas face à la guerre, mais face à un drame intime né de la guerre, où s’enracine ce sentiment de culpabilité qui pèse sur la narration au fur et à mesure que l’on avance dans le récit. La fin du livre présente une allégorie : c’est une petite fille aux yeux mauves assise en haut de l’escalier de la maison d’Elias Kassem où se rend le narrateur. La petite fille tend au narrateur une enveloppe blanche laissée pour lui par Elias Kassem qui n’est pas là et elle lui tend aussi « un minuscule fruit rouge de grenadier ». N’est-ce pas une promesse de rencontrer les vivants, le signe d’aller à la rencontre du vivant, de soi vivant, ce qui ramène à l’interrogation du tout début du livre.
Philippe GENESTE
- Culture et Révolution (6 février 2012). Samuel Holder
- Biblioblog (4 février 2013), Alice-Ange.
- L’Orient littéraire (Beyrouth) (25 octobre 2012), Fifi Aboudib.
- Coups de coeur 2013 (juin 2013), Médiathèque de Clamart.
- Info Magazine (27 mars 2012). Récit d’outre-guerre. Entretien avec Marc François
- Lisez jeunesse (15 avril 2012). Philippe Geneste
- Agenda culturel, Beyrouth (30 mars 2012). Nadim Tarazi
- L’Ecritoire des Muses (19 juillet 2012). Elias Abou-Mansour
- CultureMag (24 février 2012). Matthieu Falcone
- Cultures Sud (17 mai 2012). Vincente Duchel-Clergeau
- La Galipote (mai 2015), James Gressier.
- Union pacifiste (novembre 2012), René Burget et Bernard Baissat.
- L’Orient-Le Jour (Beyrouth) (31 octobre 2012), Nidal Ayoub.
- Clercs catholiques (avril 2013), Samih Raad.
- La Montagne (15 mars 2012). Catherine David
- ActuaLitté, 4 avril 2012
- Radio Libertaire (11 février 2012). Emission "Chroniques rebelles". Christiane Passevant
- Babelio (1er juin 2017), Lilicrapota.
- Critiques Libres (25 janvier 2012). L. Breuil
- Dissidences (juin 2012). Georges Ubbiali
- Barricade (mars 2012). Michel Lebailly
- Le Monde libertaire (27 septembre 2012). Claude Kottelanne.
- France-Info (10 mars 2012), Philippe Vallet, Le livre du jour.