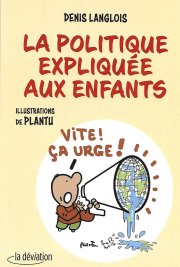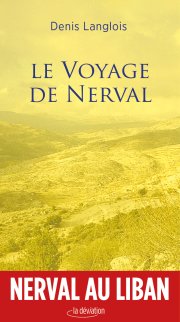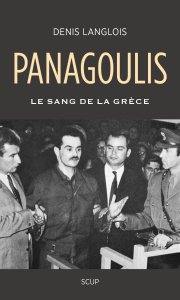- AGENDA
Les 3 et 4 juin 2023, Denis Langlois participera au Salon du livre de Ceyrat (Puy-de-Dôme), près de Clermont-Ferrand.
.
20 janvier 2022 : Parution de La Politique expliquée aux enfants de Denis Langlois, illustrée par Plantu. (Editions La Déviation)
Édition spéciale 1983-2022.
Avril 2021. "Le Voyage de Nerval" (Gérard de Nerval au Liban), récit de Denis Langlois, est paru le 15 avril 2021 aux éditions de La Déviation.
.

Mai 2020 : Le livre "Pour en finir avec l’affaire Seznec" (La Différence) de Denis Langlois (avec un cahier-photos de 16 pages) à nouveau disponible en librairie.
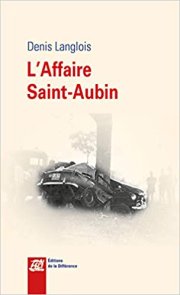
24 septembre 2019
Les Éditions de La Différence publient "L’Affaire Saint-Aubin" de Denis Langlois, avec un cahier-photos de 16 pages.
Le 25 octobre 2018, les éditions SCUP-La Déviation publient une nouvelle édition complétée et illustrée de "Panagoulis, le sang de la Grèce" de Denis Langlois.
.
ARCHIVES MILITANTES.
Nouvelles rubriques sur le site :
*La Ligue des droits de l’homme (1967-1971).
*La Fédération internationale des droits de l’homme (1968-1970).
*Les luttes militantes pour l’autodétermination du Pays Basque (1984-1997).
Chapitre 4
Le lendemain matin, aussitôt après le petit-déjeuner,je me dirige vers la porte d’entrée du couvent. Je salue le concierge indien et me retrouve dans la cour dallée.
Surtout ne pas me précipiter en direction de Fatka,marcher au contraire d’un pas tranquille, comme si j’allais faire une simple balade, regarder le couvent avec un peu de recul. La chapelle moderne et sa flèche ont toujours beaucoup d’allure, mais les murs de la forteresse qui les entourent sont toujours aussi hideux. Tout dans le coin est hideux. Devant le couvent, les bulldozers et les pelleteuses creusent le flanc bistre de la montagne et déracinent les arbres. Des poteaux électriques d’un jaune criard poussent un peu partout, les sacs en plastique volent au vent.
Je me retourne vers le couvent qui visait, quand il a été construit, à dominer la ville de Jounieh du haut de son pain de sucre. La flèche de l’église est déjà dépassée par les gigantesques pylônes blanc et rouge d’un émetteur de télévision. Deux énormes paraboles grises sont braquées vers des satellites invisibles qui tournent au-dessus de nos têtes.
Je me fiche de la religion, mais je me dis que les préoccupations spirituelles sont singulièrement en danger dans ce couvent-hôtel. À ses pieds, Jounieh, ville-champignon,capitale-bis des chrétiens, mais aussi ville de la perdition avec ses boîtes de nuit, son casino, son affairisme.Au-dessus de lui, la télé et ses émissions abrutissantes.
Fatka. Comme toi, Élias, j’ai envie de monter plus haut, toujours plus haut dans la montagne. Je dépasse les pylônes blanc et rouge gardés par deux soldats,fusils-mitrailleurs à l’épaule, et me retrouve sur une autre colline. Tout de suite je découvre une pancarte en bois qui indique la direction de Fatka. Plus de route,juste un sentier pierreux, et tout autour un terrain bouleversé avec des panneaux inquiétants « Danger mines ! »
Il fait chaud, je ne suis pas habitué. Je m’assois un instant sur un bloc de pierre, à l’ombre d’un olivier rescapé. Puis j’avance vers la première maison que flanque un poulailler où des oies font du raffut.
Je suis à présent sur la place du village, du moins sur ce qui sert de place à cet ensemble hétéroclite de bâtiments dispersés, de maisons basses traditionnelles en pierres sèches avec leur toit plat, leur tonnelle couverte de vigne,mais aussi d’immeubles de dix étages, de carcasses de béton en voie de destruction ou de construction.
Ce n’est certes pas le petit village de montagne que je m’attendais à trouver. Plusieurs cafés, un restaurant de luxe, un garage, un supermarché. Nous sommes en pays chrétien et, çà et là, devant les maisons, veillent de petites niches avec des toits de tuile abritant une statue de la Vierge ou celle d’un saint vêtu de blanc et de rouge, je n’oserais dire comme les pylônes de la télévision. Quelques beaux arbres noueux, des figuiers aux feuilles épaisses ressemblant à de grandes mains vertes,des chênes, des oliviers gris argenté. Une barrière de bois qui ceinture une vague pelouse. Des fils électriques et téléphoniques pendent jusqu’au sol en un inextricable réseau. La rue est en fait une route où les voitures et les camions défilent.
Deux chats traversent imprudemment la chaussée en se poursuivant. Ce sont les premiers que je vois. Ils sautent dans la cour d’un petit café délabré. Je les suis.
Une chance, le patron parle français. Pas très bien,en hésitant, suffisamment pour que nous puissions nous comprendre. Je commande une limonade et je m’installe à une table dans la cour.
Il a la cinquantaine, mal rasé, l’air patibulaire, une démarche de paysan matois, un regard louche. Bref, il m’inspire confiance. À défaut d’autres conversations, je me risque à lui parler de la détérioration du coin par les constructions modernes.
J’ai touché juste. Il plisse les yeux, baisse la tête, prend son élan et me montre deux énormes immeubles qui cachent la pente de la montagne. Il est furieux et, d’un seul coup, parle un excellent français.
— Vous voyez celui qui a des balcons verts, c’est le premier que l’on a construit à Fatka. Et pour qui il a été ? Pour moi. Je ne voyais plus que la moitié de la montagne. Ça ne suffisait pas, ils en ont construit un deuxième, toujours pour moi, celui aux balcons violets. Maintenant je ne vois plus rien. Ce ne sont pas des maisons. Ça n’a pas de nom. Comment ça s’appelle ?
Je ne cherche pas. Je sirote ma limonade. En fait,je bois du petit lait. Voilà un homme qui sait parler,tout simplement parce qu’il exprime avec force ce que je pense.
Je suis assis à l’ombre d’un figuier. La limonade est fraîche, pas glacée, juste ce qu’il faut. Je prends mon temps et je glisse le plus naturellement possible.
— Vous connaissez Élias Kassen ?
Une stupeur comme celle qui est apparue sur le visage de la Mère Supérieure.
— Élias Kassem, bien sûr que je le connais, ou plutôt que je le connaissais ! Un gars assez grand, un peu maigre. C’était l’un de mes clients. Je ne sais pas s’il est encore vivant. Un réfugié du Chouf, un déplacé. Dans son village, ça s’était bagarré avec les druzes. En 83, il est arrivé avec d’autres réfugiés. D’abord, il a été hébergé à Jounieh au monastère arménien, puis au couvent Notre-Dame.Ensuite il est monté ici, avec juste un sac. Il a loué une petite maison un peu plus haut, il allait travailler à Jounieh tous les jours. À pied ou en faisant du stop.Une hésitation.
— Jamais il n’a voulu faire partie des milices. Ici,c’était surtout les Forces libanaises. On le menaçait, on le provoquait, on l’appelait « Élias le dégonflé ». De temps en temps, il venait me voir. Pas très bon pour mon commerce, mais de toute façon pendant la guerre les clients ne se bousculaient pas…Il s’arrête, baisse à nouveau la tête. Je remarque qu’il aune petite tonsure au sommet du crâne.
— C’est curieux, reprend-il en me regardant légèrement de biais, il s’asseyait toujours à la table où vous êtes.Pour le rassurer, je lui signale que c’est la plus ombragée, la plus tranquille. Il ne m’entend pas, il cherche à se souvenir.
— Oui, toujours à cette table. Il ne buvait pas de limonade, mais du café turc, dans une tasse sans anse, un fenjan. Il la prenait au creux de sa main, comme pour se réchauffer, et il buvait lentement à petites gorgées…Nouvelle pause afin de se rappeler.
— Quand la guerre s’est terminée, dès qu’il a pu re tourner dans sa montagne, il est parti. Il avait deux sacs noirs qu’il portait sur la même épaule. Il a bu un dernier café, deux même, m’a serré la main et s’est éloigné à pied sur la route.
— Vous savez où il est allé ?
— Non. À Barouk je suppose, dans la montagne du Chouf, là où il y a une forêt de cèdres. Il était de ce coin.Je lampe la dernière gorgée de limonade et laisse sur la table la plus grosse pièce de monnaie que je trouve dans ma poche. Je commence à me lever, je suis en train d’écarter derrière moi la chaise. Je l’entends murmurer.
— Vous pouvez aller voir l’endroit où il vivait. Une maison basse en pierre. Pas moyen de se tromper. Juste en face de l’église. Je crois qu’elle n’est plus habitée. Allez voir aussi l’institutrice. Elle l’a mieux connu que moi…
C’est tout. Il repart dans sa cuisine. Je l’entends qui fourgonne au milieu des gamelles.
Afin de ne pas m’exposer aux reproches de la Mère Supérieure qui est à cheval sur les horaires, je dégringole vers le couvent pour aller manger une purée de pois chiches et un poulet au riz de bonne facture. Aussitôt le dessert avalé, une assiettée de cerises, je remonte vers Fatka.
Je passe devant le café, en faisant un signe amical de la main au patron qui ne répond pas. Quelques centaines de mètres encore le long de la route surchauffée sans trottoir,j’aperçois le clocher de l’église.
Devant le portail se dresse un énorme chêne qui doit être plus que centenaire si j’en crois son tronc balafré de partout. L’église est encore plus ancienne, mais a dû être restaurée récemment tant ses pierres taillées sont blanches.Quatre marches en demi-cercle mènent à une porte debois sculpté. Pas très haute. J’ai lu que, sous l’occupation ottomane, on construisait des portails bas pour empêche rles Turcs d’entrer à cheval dans les églises. Sur le côté,pend une grosse corde à nœuds qui permet d’actionner l’une des cloches, celle qui doit servir à appeler les paroissiens à la messe, à sonner le tocsin lorsqu’il y a le feu, ou bien la guerre.
Je suis assis sur une pierre, à l’ombre du chêne dont les feuilles sous la chaleur piquent du nez. C’est le moment de me retourner et de regarder dans le prolongement du portail.
D’abord, je ne vois rien, trop de soleil, trop de blancheur. Puis peu à peu la montagne vire au brun rosé,couleur bruyère. Derrière un affreux poteau électrique rouillé, je repère un muret rectiligne plus foncé.
Et brusquement j’ai devant moi ta maison, Élias. Pas tout de suite, mes yeux ont encore à parcourir un petit chemin de terre d’une cinquantaine de mètres. Mais elle est là en face de moi. Basse, en pierre jaune, avec une terrasse et une tonnelle couverte de vigne. Pas besoin de me demander s’il s’agit bien d’elle. Je le sais, parce que j’aurais envie d’y habiter.
Je me lève lentement, je traverse la route et m’engage dans le chemin. Malgré moi, ému, je ralentis le pas. Je m’immobilise.
Je suis en plein soleil et pourtant je sens déjà la fraîcheur de l’ombre bleutée de la tonnelle. Accrochée au treillis, la vigne est lourde de feuilles et de grappes pas encore mûres.Je sais à quel endroit tu t’installais, Élias, j’ai repéré sur la gauche de la porte un petit banc de bois au dossier usé.Je sais que, dans le gros pot de terre aujourd’hui vide, ily avait un géranium rouge, que le seau de fer renversé et troué n’était pas là et que la peinture brune de la porte et des volets n’était pas écaillée.
Je m’avance, je vais atteindre la ligne de l’ombre bleue, quand une voix tonnante s’élève derrière moi. Je me retourne. Un gros homme âgé, en tricot blanc, chauve, les poings sur les hanches, me demande ce que je veux. En arabe, mais j’ai compris. Je devrais – il est encore temps – répondre en parlant de la beauté de la maison, hocher la tête, lever le pouce, faire comprendre que je l’apprécie et que j’en félicite le propriétaire, mais je m’entends articuler distinctement.
— C’est bien là qu’habitait Élias Kassem ?
Cher Élias, il comprend que je te cherche. Alors, il est pris de fureur, il secoue ses épaules grasses et montre ses dix doigts en me désignant la route.
Il se trompe un peu sur les années, la guerre n’est finie que depuis huit ans, mais il veut me dire que tu es parti, bon débarras, que tu as refermé une dernière fois la porte brune, que tu lui as remis la grosse clé de fer et que tu t’es éloigné sur le chemin, tes deux sacs noirs sur la même épaule.
Il en ouvre tout grand la bouche et je vois qu’il lui manque plusieurs dents.
Moi aussi, comme toi autrefois, Élias, je m’éloigne sur le chemin, je prends la route sur la gauche. T’es-tu retourné une dernière fois pour apercevoir la vigne ? Dans le doute, je me retourne.
Le propriétaire – c’est peut-être seulement le voisin –est planté au milieu du chemin, les poings sur les hanches,toujours furieux. Il me salue d’un bras d’honneur.
Le lendemain matin, aussitôt après le petit-déjeuner,je me dirige vers la porte d’entrée du couvent. Je salue le concierge indien et me retrouve dans la cour dallée.
Surtout ne pas me précipiter en direction de Fatka,marcher au contraire d’un pas tranquille, comme si j’allais faire une simple balade, regarder le couvent avec un peu de recul. La chapelle moderne et sa flèche ont toujours beaucoup d’allure, mais les murs de la forteresse qui les entourent sont toujours aussi hideux. Tout dans le coin est hideux. Devant le couvent, les bulldozers et les pelleteuses creusent le flanc bistre de la montagne et déracinent les arbres. Des poteaux électriques d’un jaune criard poussent un peu partout, les sacs en plastique volent au vent.
Je me retourne vers le couvent qui visait, quand il a été construit, à dominer la ville de Jounieh du haut de son pain de sucre. La flèche de l’église est déjà dépassée par les gigantesques pylônes blanc et rouge d’un émetteur de télévision. Deux énormes paraboles grises sont braquées vers des satellites invisibles qui tournent au-dessus de nos têtes.
Je me fiche de la religion, mais je me dis que les préoccupations spirituelles sont singulièrement en danger dans ce couvent-hôtel. À ses pieds, Jounieh, ville-champignon,capitale-bis des chrétiens, mais aussi ville de la perdition avec ses boîtes de nuit, son casino, son affairisme.Au-dessus de lui, la télé et ses émissions abrutissantes.
Fatka. Comme toi, Élias, j’ai envie de monter plus haut, toujours plus haut dans la montagne. Je dépasse les pylônes blanc et rouge gardés par deux soldats,fusils-mitrailleurs à l’épaule, et me retrouve sur une autre colline. Tout de suite je découvre une pancarte en bois qui indique la direction de Fatka. Plus de route,juste un sentier pierreux, et tout autour un terrain bouleversé avec des panneaux inquiétants « Danger mines ! »
Il fait chaud, je ne suis pas habitué. Je m’assois un instant sur un bloc de pierre, à l’ombre d’un olivier rescapé. Puis j’avance vers la première maison que flanque un poulailler où des oies font du raffut.
Je suis à présent sur la place du village, du moins sur ce qui sert de place à cet ensemble hétéroclite de bâtiments dispersés, de maisons basses traditionnelles en pierres sèches avec leur toit plat, leur tonnelle couverte de vigne,mais aussi d’immeubles de dix étages, de carcasses de béton en voie de destruction ou de construction.
Ce n’est certes pas le petit village de montagne que je m’attendais à trouver. Plusieurs cafés, un restaurant de luxe, un garage, un supermarché. Nous sommes en pays chrétien et, çà et là, devant les maisons, veillent de petites niches avec des toits de tuile abritant une statue de la Vierge ou celle d’un saint vêtu de blanc et de rouge, je n’oserais dire comme les pylônes de la télévision. Quelques beaux arbres noueux, des figuiers aux feuilles épaisses ressemblant à de grandes mains vertes,des chênes, des oliviers gris argenté. Une barrière de bois qui ceinture une vague pelouse. Des fils électriques et téléphoniques pendent jusqu’au sol en un inextricable réseau. La rue est en fait une route où les voitures et les camions défilent.
Deux chats traversent imprudemment la chaussée en se poursuivant. Ce sont les premiers que je vois. Ils sautent dans la cour d’un petit café délabré. Je les suis.
Une chance, le patron parle français. Pas très bien,en hésitant, suffisamment pour que nous puissions nous comprendre. Je commande une limonade et je m’installe à une table dans la cour.
Il a la cinquantaine, mal rasé, l’air patibulaire, une démarche de paysan matois, un regard louche. Bref, il m’inspire confiance. À défaut d’autres conversations, je me risque à lui parler de la détérioration du coin par les constructions modernes.
J’ai touché juste. Il plisse les yeux, baisse la tête, prend son élan et me montre deux énormes immeubles qui cachent la pente de la montagne. Il est furieux et, d’un seul coup, parle un excellent français.
— Vous voyez celui qui a des balcons verts, c’est le premier que l’on a construit à Fatka. Et pour qui il a été ? Pour moi. Je ne voyais plus que la moitié de la montagne. Ça ne suffisait pas, ils en ont construit un deuxième, toujours pour moi, celui aux balcons violets. Maintenant je ne vois plus rien. Ce ne sont pas des maisons. Ça n’a pas de nom. Comment ça s’appelle ?
Je ne cherche pas. Je sirote ma limonade. En fait,je bois du petit lait. Voilà un homme qui sait parler,tout simplement parce qu’il exprime avec force ce que je pense.
Je suis assis à l’ombre d’un figuier. La limonade est fraîche, pas glacée, juste ce qu’il faut. Je prends mon temps et je glisse le plus naturellement possible.
— Vous connaissez Élias Kassen ?
Une stupeur comme celle qui est apparue sur le visage de la Mère Supérieure.
— Élias Kassem, bien sûr que je le connais, ou plutôt que je le connaissais ! Un gars assez grand, un peu maigre. C’était l’un de mes clients. Je ne sais pas s’il est encore vivant. Un réfugié du Chouf, un déplacé. Dans son village, ça s’était bagarré avec les druzes. En 83, il est arrivé avec d’autres réfugiés. D’abord, il a été hébergé à Jounieh au monastère arménien, puis au couvent Notre-Dame.Ensuite il est monté ici, avec juste un sac. Il a loué une petite maison un peu plus haut, il allait travailler à Jounieh tous les jours. À pied ou en faisant du stop.Une hésitation.
— Jamais il n’a voulu faire partie des milices. Ici,c’était surtout les Forces libanaises. On le menaçait, on le provoquait, on l’appelait « Élias le dégonflé ». De temps en temps, il venait me voir. Pas très bon pour mon commerce, mais de toute façon pendant la guerre les clients ne se bousculaient pas…Il s’arrête, baisse à nouveau la tête. Je remarque qu’il aune petite tonsure au sommet du crâne.
— C’est curieux, reprend-il en me regardant légèrement de biais, il s’asseyait toujours à la table où vous êtes.Pour le rassurer, je lui signale que c’est la plus ombragée, la plus tranquille. Il ne m’entend pas, il cherche à se souvenir.
— Oui, toujours à cette table. Il ne buvait pas de limonade, mais du café turc, dans une tasse sans anse, un fenjan. Il la prenait au creux de sa main, comme pour se réchauffer, et il buvait lentement à petites gorgées…Nouvelle pause afin de se rappeler.
— Quand la guerre s’est terminée, dès qu’il a pu re tourner dans sa montagne, il est parti. Il avait deux sacs noirs qu’il portait sur la même épaule. Il a bu un dernier café, deux même, m’a serré la main et s’est éloigné à pied sur la route.
— Vous savez où il est allé ?
— Non. À Barouk je suppose, dans la montagne du Chouf, là où il y a une forêt de cèdres. Il était de ce coin.Je lampe la dernière gorgée de limonade et laisse sur la table la plus grosse pièce de monnaie que je trouve dans ma poche. Je commence à me lever, je suis en train d’écarter derrière moi la chaise. Je l’entends murmurer.
— Vous pouvez aller voir l’endroit où il vivait. Une maison basse en pierre. Pas moyen de se tromper. Juste en face de l’église. Je crois qu’elle n’est plus habitée. Allez voir aussi l’institutrice. Elle l’a mieux connu que moi…
C’est tout. Il repart dans sa cuisine. Je l’entends qui fourgonne au milieu des gamelles.
Afin de ne pas m’exposer aux reproches de la Mère Supérieure qui est à cheval sur les horaires, je dégringole vers le couvent pour aller manger une purée de pois chiches et un poulet au riz de bonne facture. Aussitôt le dessert avalé, une assiettée de cerises, je remonte vers Fatka.
Je passe devant le café, en faisant un signe amical de la main au patron qui ne répond pas. Quelques centaines de mètres encore le long de la route surchauffée sans trottoir,j’aperçois le clocher de l’église.
Devant le portail se dresse un énorme chêne qui doit être plus que centenaire si j’en crois son tronc balafré de partout. L’église est encore plus ancienne, mais a dû être restaurée récemment tant ses pierres taillées sont blanches.Quatre marches en demi-cercle mènent à une porte debois sculpté. Pas très haute. J’ai lu que, sous l’occupation ottomane, on construisait des portails bas pour empêche rles Turcs d’entrer à cheval dans les églises. Sur le côté,pend une grosse corde à nœuds qui permet d’actionner l’une des cloches, celle qui doit servir à appeler les paroissiens à la messe, à sonner le tocsin lorsqu’il y a le feu, ou bien la guerre.
Je suis assis sur une pierre, à l’ombre du chêne dont les feuilles sous la chaleur piquent du nez. C’est le moment de me retourner et de regarder dans le prolongement du portail.
D’abord, je ne vois rien, trop de soleil, trop de blancheur. Puis peu à peu la montagne vire au brun rosé,couleur bruyère. Derrière un affreux poteau électrique rouillé, je repère un muret rectiligne plus foncé.
Et brusquement j’ai devant moi ta maison, Élias. Pas tout de suite, mes yeux ont encore à parcourir un petit chemin de terre d’une cinquantaine de mètres. Mais elle est là en face de moi. Basse, en pierre jaune, avec une terrasse et une tonnelle couverte de vigne. Pas besoin de me demander s’il s’agit bien d’elle. Je le sais, parce que j’aurais envie d’y habiter.
Je me lève lentement, je traverse la route et m’engage dans le chemin. Malgré moi, ému, je ralentis le pas. Je m’immobilise.
Je suis en plein soleil et pourtant je sens déjà la fraîcheur de l’ombre bleutée de la tonnelle. Accrochée au treillis, la vigne est lourde de feuilles et de grappes pas encore mûres.Je sais à quel endroit tu t’installais, Élias, j’ai repéré sur la gauche de la porte un petit banc de bois au dossier usé.Je sais que, dans le gros pot de terre aujourd’hui vide, ily avait un géranium rouge, que le seau de fer renversé et troué n’était pas là et que la peinture brune de la porte et des volets n’était pas écaillée.
Je m’avance, je vais atteindre la ligne de l’ombre bleue, quand une voix tonnante s’élève derrière moi. Je me retourne. Un gros homme âgé, en tricot blanc, chauve, les poings sur les hanches, me demande ce que je veux. En arabe, mais j’ai compris. Je devrais – il est encore temps – répondre en parlant de la beauté de la maison, hocher la tête, lever le pouce, faire comprendre que je l’apprécie et que j’en félicite le propriétaire, mais je m’entends articuler distinctement.
— C’est bien là qu’habitait Élias Kassem ?
Cher Élias, il comprend que je te cherche. Alors, il est pris de fureur, il secoue ses épaules grasses et montre ses dix doigts en me désignant la route.
Il se trompe un peu sur les années, la guerre n’est finie que depuis huit ans, mais il veut me dire que tu es parti, bon débarras, que tu as refermé une dernière fois la porte brune, que tu lui as remis la grosse clé de fer et que tu t’es éloigné sur le chemin, tes deux sacs noirs sur la même épaule.
Il en ouvre tout grand la bouche et je vois qu’il lui manque plusieurs dents.
Moi aussi, comme toi autrefois, Élias, je m’éloigne sur le chemin, je prends la route sur la gauche. T’es-tu retourné une dernière fois pour apercevoir la vigne ? Dans le doute, je me retourne.
Le propriétaire – c’est peut-être seulement le voisin –est planté au milieu du chemin, les poings sur les hanches,toujours furieux. Il me salue d’un bras d’honneur.
- Articles et émissions concernant Le Déplacé
- Liban 1998 - Photos
- Premiers chapitres
- Chapitre 1
- Chapitre 2
- Chapitre 3
- Chapitre 4
- Documents concernant Le Déplacé
- Témoignage du Père Samih Raad, ancien curé de Maasser-el-Chouf (22 février 2012)
- Témoignage d’Élias Chakar, chrétien rescapé du massacre de Maasser-ech-Chouf.
- La guerre est-elle inhérente à la nature humaine ? (Guerre du Liban)
- Photos Beyrouth 2012
- Salon du Livre francophone de Beyrouth 2012
- Le Voyage de Nerval (Gérard de Nerval au Liban)
- Liban. Le Déplacé et Le Voyage de Nerval