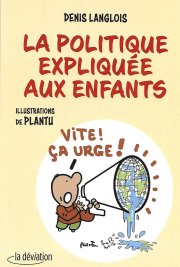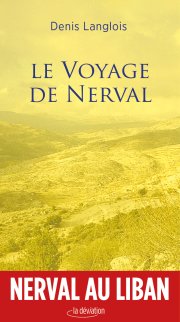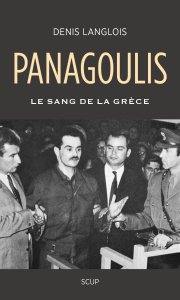- AGENDA
Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2024, Denis Langlois vous attend au SALON DU LIVRE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, salle des 4 Saisons, avenue de l’Hippodrome, sur le stand de la Librairie Le Furet du Nord.

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2024, Denis Langlois sera au SALON DU LIVRE "Marque-page", à CÉBAZAT (Puy-de-Dôme), Domaine de la Prade, 46 route de Gerzat, près de Clermont-Ferrand, sur le stand des Editions La Déviation.

.
Le samedi 28 septembre 2024, à 15 heures, à MONNERVILLE (Essonne), CONFÉRENCE-DÉBAT "La Mort du babouin de Monnerville".
Le 22 août 2024, parution d’un nouveau livre aux éditions La Déviation : La Cavale du babouin
En 2022 : Parution de La Politique expliquée aux enfants de Denis Langlois, illustrée par Plantu. (Editions La Déviation)
Édition spéciale 1983-2022.
.
2021. "Le Voyage de Nerval" (Gérard de Nerval au Liban), récit de Denis Langlois, paraît aux éditions de La Déviation.
.

Paru en 2020 le livre "Pour en finir avec l’affaire Seznec" (La Différence) de Denis Langlois (avec un cahier-photos de 16 pages) sera bientôt à nouveau disponible en librairie.
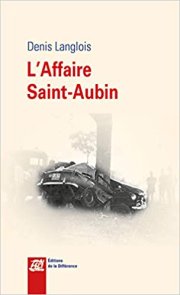
2019
Les Éditions de La Différence publient "L’Affaire Saint-Aubin" de Denis Langlois, avec un cahier-photos de 16 pages.
2018, les éditions SCUP-La Déviation publient une nouvelle édition complétée et illustrée de "Panagoulis, le sang de la Grèce" de Denis Langlois.
.
ARCHIVES MILITANTES.
Nouvelles rubriques sur le site :
*La Ligue des droits de l’homme (1967-1971).
*La Fédération internationale des droits de l’homme (1968-1970).
*Les luttes militantes pour l’autodétermination du Pays Basque (1984-1997).
Chapitre 1
.
Même s’il était un peu brouillon, mon père aimait les dates exactes. Il est mort le 1er janvier 1995. C’est le premier cadavre que j’ai vu et touché. Il m’a fallu attendre 55 ans pour faire cette expérience dans une petite morgue de la région parisienne. On m’a demandé si je voulais le voir une dernière fois, avant qu’on ne le mette en bière. « Non ! » a crié derrière moi l’un de mes frères sur un ton terrifié. C’est ce ton terrifié qui m’a poussé à le contredire en répondant « Oui ». Je l’aurais fait de toute façon, là je n’ai pas hésité. Je n’admettais pas que l’on soit épouvanté devant la mort. Je me lançais aussi un défi, car j’ignorais quelles seraient mes réactions devant le cadavre de mon père.
Derrière la porte en fer, on a poussé un chariot, puis on m’a fait entrer. Couché sur le dos, mon père était pâle,son front dégarni auréolé de cheveux gris, ses sourcils broussailleux sur des yeux fermés sans lunettes. Je me suis penché et je l’ai embrassé. Le contact avec sa peau glacée m’a surpris. Juste une parcelle de seconde, le temps de réaliser que c’était normal puisqu’il était mort. Je suis resté debout devant le chariot à le regarder, sa poitrine bombée sous le drap tendu. Très rapidement ce n’est plus lui que j’ai vu. Cela peut sembler surprenant et je ne chercherai pas à l’expliquer, mais, alors que je lui tournais le dos, je voyais mon frère dans l’embrasure de la porte. Immobile, la veste boutonnée trop haut, presque jusqu’au cou, il regardait le cadavre de son père. J’ai su, avant qu’il fasse le moindre geste, qu’il allait se reculer et partir sans entrer dans la pièce. À vrai dire, je ne l’ai pas su. Je l’ai senti.Du fond de moi, je l’encourageais : « Entre, tu n’as rien à craindre ». Un bref instant, j’ai perçu qu’il hésitait, puis j’ai entendu son talon crisser sur le carreau. Je ne me suis pas retourné. Inutile. Je savais que je venais de perdre à la fois mon père et mon frère, car je pressentais que je ne l’absoudrais pas d’avoir eu peur de la mort.
Je ne savais pas que la suite allait être encore plus pénible. Je ne pouvais pas le savoir parce que, le lendemain, il est tombé une neige éclatante. J’avais vu des neiges plus éclatantes, des neiges de montagne,des neiges qui se transforment tout de suite en glace et éclaboussent de lumière. Là c’était une neige subite que rien n’annonçait. J’étais dans le corbillard, assis sur un siège gris foncé un peu en retrait derrière le chauffeur.Sous ma main, dans un coffre de bois gris foncé lui aussi,reposait le cercueil de mon père. Je touchais le bois et j’avais l’impression de toucher mon père, de l’emmener dans son dernier voyage.
Je me disais « Il a de la chance. Il doit apprécier ce paysage entièrement blanc. Il doit se souvenir comme je me souviens ». Nous roulions vers un crématorium, puisqu’il avait souhaité être incinéré. Nous prenions surtout la route de Paris. Enfant, j’avais souvent fait ce parcours avec lui.Il était commerçant, il vendait des pièces détachées pour automobiles et tous les lundis il allait à Paris s’approvisionner. Au temps des vacances, j’aimais l’accompagner. Nous partions tôt le matin et, à l’aller, j’étais auprès de lui à l’avant de la voiture, les yeux bien ouverts, fixant la route. Le soir, à la nuit tombante, la fatigue me prenait, je m’endormais à l’arrière sur la banquette, au milieu des boîtes et des paquets, dans l’odeur de fer et de caoutchouc.À vrai dire, je ne m’endormais pas, je recherchais une sensation exceptionnelle. Je sommeillais, avec la confiance absolue que rien ne pouvait m’arriver parce que mon père conduisait. Je voyais au-dessus de moi s’entrecroiser les reflets des phares des voitures. Quand mon père parfois se retournait, je fermais aussitôt les yeux pour lui montrer que j’étais entièrement sous sa protection, que je n’avais pas d’autre rempart que lui, je dépendais totalement de sa dextérité et de sa prudence au volant. Avec les vibrations du moteur, il arrivait que je m’endorme vraiment, cependant du fond de mon sommeil je sentais cette protection.Elle me berçait, elle m’enveloppait. La voiture finissait par se ranger devant la maison qui était en même temps la boutique. Je faisais encore semblant de dormir pou rentendre le « On est arrivé ». Parfois, j’attendais la main qui se posait sur mon épaule et me secouait.
En ce matin de neige, nous empruntions la même route. Ce n’était pas mon père qui conduisait, mais un homme pas très bien rasé habillé en noir avec une casquette sur le crâne. Mon père, lui, était couché à l’arrière du fourgon, comme moi autrefois. J’imaginais que les rôles étaient inversés : je tenais le volant, il faisait semblant de dormir sur la banquette. Je n’étais pas sûr de pouvoir lui assurer la sécurité de jadis, j’espérais seulement qu’il sentait ma main posée sur le bois du coffre gris foncé.
Le fourgon s’est arrêté dans le jardin du crématorium. J’ai retrouvé ma famille rangée le long d’un muret notamment ma mère, toute petite, les cheveux écrasés sous une écharpe, ratatinée par cette épreuve qui lui tombait sur la tête. Mon frère, le fuyard de la morgue,s’est approché de moi.
— Pour Maman, j’ai demandé que la cérémonie soit écourtée. Je ne crois pas qu’elle pourrait la supporter.
Je n’ai rien répondu. Je suis resté silencieux lorsque quatre hommes habillés de noir ont apporté en hâte le cercueil recouvert d’un tissu de velours pourpre. Je n’ai rien dit quand dans une salle voûtée on a bâclé la cérémonie avec deux airs funèbres de Bach et de Mozart. Mais je n’ai pu résister quand j’ai compris que le cercueil allait disparaître par une trappe pour se retrouver dans le four. Je ne sais pas ce qui m’a pris. Je serais incapable de me souvenir de mes gestes et de mes mots exacts. Je me suis levé, bouleversé,indigné, et j’ai dit « On ne peut pas le laisser partir comme cela ! J’ai posé une dernière fois la main sur le cercueil en balbutiant un « Merci » ou un « Au revoir ».
C’est vers cette période – un psychanalyste dirait que tout est lié – que j’ai perdu mes illusions politiques. Même après la chute du mur de Berlin, même après l’effondrement des régimes communistes, je restais persuadé que la révolution était possible. Simplement on s’y était mal pris,on avait eu tort d’employer la violence, on avait récolté la violence. On avait recréé des classes sociales. Mais un jour,c’était sûr, il existerait une société plus juste, plus libre,plus fraternelle. L’écrivain que j’étais l’avait certifié dans un livre au titre volontariste qui n’avait trompé personne : « Les partageux ne meurent jamais ».
Je continuais à me lever chaque matin, à lacer mes chaussures, en me disant que j’allais œuvrer, pas seul bien sûr, mais avec des millions d’autres, à l’avènement de cette société paradisiaque. C’est ce mot de « paradisiaque » que je me suis surpris à prononcer qui a commencé à semer le doute dans mon esprit. Je n’étais pas croyant, mais je me suis rendu compte que j’avais une foi quasi religieuse en la révolution. Je n’espérais pas en un paradis céleste, mais en un paradis terrestre qui lui ressemblait singulièrement.En fait, je poursuivais l’éternelle et insaisissable utopie qui depuis toujours taraude les hommes qui veulent donner un sens à la vie.
Une interrogation sacrilège et désespérante se glissait peu à peu en moi : la tâche à laquelle j’avais consacré l’essentiel de ma vie, depuis mon adolescence influencée justement par mon père, n’était-elle pas irrémédiablement vaine ? Pour changer la société injuste dans laquelle nous vivions, il fallait d’abord changer les êtres humains qui la composaient. Or, ces êtres humains n’avaient guère l’intention, ni surtout la possibilité, de changer. Ils se contentaient de mettre en œuvre leur nature humaine de toujours. J’étais allé en Yougoslavie, j’avais été effaré devoir comment des gens apparemment civilisés pouvaient sombrer dans la barbarie la plus complète et se massacre rentre voisins.
Jusque-là, je pensais que la société progressait. Avec certes de terribles retours en arrière, des dents de scie qui mordaient profondément dans la chair des hommes. Mais elle progressait. À présent, je n’en étais plus très sûr. Ma représentation géométrique de ce progrès était une ligne qui montait vers le ciel. Je voyais maintenant un cercle qui tournait sur lui-même, sans se déplacer d’un centimètre.
Quand je me penchais sur les actions que j’avais menées, je me posais des questions : avaient-elles été bénéfiques ou nuisibles ? Comme beaucoup de militants j’avais soutenu des luttes de libération, l’Algérie, le Vietnam, Cuba, qui avaient débouché sur des dictatures aussi critiquables que le régime précédent. Je me demandais si on avait le droit d’agir lorsqu’on était incapable de prévoir les résultats de son action à moyen et à long terme. N’était-ce pas tout simplement de l’irresponsabilité ? Et moi, l’intellectuel de gauche à la bonne conscience, je remettais en cause la quinzaine de livres que j’avais écrits, mes défenses d’avocat spécialisé dans les droits de l’homme, mes interventions, mes délégations à l’étranger. Ma vie. Brutalement, c’était comme si je n’avais rien fait de cette existence. Elle était creuse, elle n’avait fait que tourner elle aussi sur elle-même. Je gardais l’envie d’aider les autres, j’en voyais la nécessité, mais je me posais tant de questions, j’avais tant de scrupules, que je me retenais d’agir pour ne pas risquer de porter tort à ceux que je voulais aider.
Il arrivait qu’on me parlât avec chaleur d’un de mes livres ou d’une action à laquelle j’avais participé. J’éprouvais beaucoup de difficultés à me dire que j’en étais l’auteur. Je n’avais plus de passé. Un grand trou derrière moi et sous mes pieds un sol guère plus solide.
Restait l’amour. Même pas. Ma compagne de longtemps, je me rendais compte que je l’avais choisie et aimée parce qu’elle était une complice de combat, parce qu’à deux on abat plus de besogne, on est plus efficace. Le combat entouré de sentiments est toujours plus attrayant. Maintenant, faute d’actions communes, je m’ennuyais avec elle. De plus, elle comprenait mal ma nouvelle attitude. Avec son aide, j’étais parvenu à me bâtir une certaine notoriété dans le milieu militant des droits de l’homme,j’y étais plutôt estimé. Aujourd’hui, je faisais en sorte de démolir cette notoriété. Je refusais tout, les émissions de télévision et de radio, les conférences, même les signatures de pétitions qui ne demandent aucun effort. Je n’aspirais qu’à une chose : me mettre à l’écart dans la verdure, pour réfléchir, mais surtout me reconstruire. Ma compagne, elle, ne jurait que par la ville, et par Paris où elle avait toujours vécu. Elle trouvait aberrant de consacrer l’essentiel de nos maigres économies à acheter une petite maison dans un trou perdu où il ne se passerait rien d’intéressant.
Un jour, l’ennui et le désaccord me sont apparus trop importants, j’ai décidé de partir.
Pas de partir pour des vacances au bord de la mer ou à la campagne dans la fameuse petite maison. Me retirer, disparaître en quelque sorte, si possible loin, en changeant totalement de vie. Je pensais qu’éloigné de ce que j’avais jusqu’ici vécu, je pourrais peut-être rebâtir autre chose et d’abord moi-même, donner un sens à la dernière partie de mon existence.
J’étais prêt à n’importe quelle proposition, même la plus extravagante. On ne me proposait que de continuer ce que j’avais fait jusqu’ici, c’est-à-dire des actions militantes. J’expliquais que je cherchais autre chose, sans bien savoir quoi. On ne me comprenait pas, dans le pire des cas on me considérait comme un lâcheur qui, comme tant d’autres, renonçait à la lutte.
J’ai fini par comprendre que je n’avais plus qu’un allié : le hasard. Si je voulais continuer à vivre, j’étais obligé de m’en remettre totalement à lui. Il était le seul terrain à peu près solide sur lequel je pouvais m’appuyer.
.
Même s’il était un peu brouillon, mon père aimait les dates exactes. Il est mort le 1er janvier 1995. C’est le premier cadavre que j’ai vu et touché. Il m’a fallu attendre 55 ans pour faire cette expérience dans une petite morgue de la région parisienne. On m’a demandé si je voulais le voir une dernière fois, avant qu’on ne le mette en bière. « Non ! » a crié derrière moi l’un de mes frères sur un ton terrifié. C’est ce ton terrifié qui m’a poussé à le contredire en répondant « Oui ». Je l’aurais fait de toute façon, là je n’ai pas hésité. Je n’admettais pas que l’on soit épouvanté devant la mort. Je me lançais aussi un défi, car j’ignorais quelles seraient mes réactions devant le cadavre de mon père.
Derrière la porte en fer, on a poussé un chariot, puis on m’a fait entrer. Couché sur le dos, mon père était pâle,son front dégarni auréolé de cheveux gris, ses sourcils broussailleux sur des yeux fermés sans lunettes. Je me suis penché et je l’ai embrassé. Le contact avec sa peau glacée m’a surpris. Juste une parcelle de seconde, le temps de réaliser que c’était normal puisqu’il était mort. Je suis resté debout devant le chariot à le regarder, sa poitrine bombée sous le drap tendu. Très rapidement ce n’est plus lui que j’ai vu. Cela peut sembler surprenant et je ne chercherai pas à l’expliquer, mais, alors que je lui tournais le dos, je voyais mon frère dans l’embrasure de la porte. Immobile, la veste boutonnée trop haut, presque jusqu’au cou, il regardait le cadavre de son père. J’ai su, avant qu’il fasse le moindre geste, qu’il allait se reculer et partir sans entrer dans la pièce. À vrai dire, je ne l’ai pas su. Je l’ai senti.Du fond de moi, je l’encourageais : « Entre, tu n’as rien à craindre ». Un bref instant, j’ai perçu qu’il hésitait, puis j’ai entendu son talon crisser sur le carreau. Je ne me suis pas retourné. Inutile. Je savais que je venais de perdre à la fois mon père et mon frère, car je pressentais que je ne l’absoudrais pas d’avoir eu peur de la mort.
Je ne savais pas que la suite allait être encore plus pénible. Je ne pouvais pas le savoir parce que, le lendemain, il est tombé une neige éclatante. J’avais vu des neiges plus éclatantes, des neiges de montagne,des neiges qui se transforment tout de suite en glace et éclaboussent de lumière. Là c’était une neige subite que rien n’annonçait. J’étais dans le corbillard, assis sur un siège gris foncé un peu en retrait derrière le chauffeur.Sous ma main, dans un coffre de bois gris foncé lui aussi,reposait le cercueil de mon père. Je touchais le bois et j’avais l’impression de toucher mon père, de l’emmener dans son dernier voyage.
Je me disais « Il a de la chance. Il doit apprécier ce paysage entièrement blanc. Il doit se souvenir comme je me souviens ». Nous roulions vers un crématorium, puisqu’il avait souhaité être incinéré. Nous prenions surtout la route de Paris. Enfant, j’avais souvent fait ce parcours avec lui.Il était commerçant, il vendait des pièces détachées pour automobiles et tous les lundis il allait à Paris s’approvisionner. Au temps des vacances, j’aimais l’accompagner. Nous partions tôt le matin et, à l’aller, j’étais auprès de lui à l’avant de la voiture, les yeux bien ouverts, fixant la route. Le soir, à la nuit tombante, la fatigue me prenait, je m’endormais à l’arrière sur la banquette, au milieu des boîtes et des paquets, dans l’odeur de fer et de caoutchouc.À vrai dire, je ne m’endormais pas, je recherchais une sensation exceptionnelle. Je sommeillais, avec la confiance absolue que rien ne pouvait m’arriver parce que mon père conduisait. Je voyais au-dessus de moi s’entrecroiser les reflets des phares des voitures. Quand mon père parfois se retournait, je fermais aussitôt les yeux pour lui montrer que j’étais entièrement sous sa protection, que je n’avais pas d’autre rempart que lui, je dépendais totalement de sa dextérité et de sa prudence au volant. Avec les vibrations du moteur, il arrivait que je m’endorme vraiment, cependant du fond de mon sommeil je sentais cette protection.Elle me berçait, elle m’enveloppait. La voiture finissait par se ranger devant la maison qui était en même temps la boutique. Je faisais encore semblant de dormir pou rentendre le « On est arrivé ». Parfois, j’attendais la main qui se posait sur mon épaule et me secouait.
En ce matin de neige, nous empruntions la même route. Ce n’était pas mon père qui conduisait, mais un homme pas très bien rasé habillé en noir avec une casquette sur le crâne. Mon père, lui, était couché à l’arrière du fourgon, comme moi autrefois. J’imaginais que les rôles étaient inversés : je tenais le volant, il faisait semblant de dormir sur la banquette. Je n’étais pas sûr de pouvoir lui assurer la sécurité de jadis, j’espérais seulement qu’il sentait ma main posée sur le bois du coffre gris foncé.
Le fourgon s’est arrêté dans le jardin du crématorium. J’ai retrouvé ma famille rangée le long d’un muret notamment ma mère, toute petite, les cheveux écrasés sous une écharpe, ratatinée par cette épreuve qui lui tombait sur la tête. Mon frère, le fuyard de la morgue,s’est approché de moi.
— Pour Maman, j’ai demandé que la cérémonie soit écourtée. Je ne crois pas qu’elle pourrait la supporter.
Je n’ai rien répondu. Je suis resté silencieux lorsque quatre hommes habillés de noir ont apporté en hâte le cercueil recouvert d’un tissu de velours pourpre. Je n’ai rien dit quand dans une salle voûtée on a bâclé la cérémonie avec deux airs funèbres de Bach et de Mozart. Mais je n’ai pu résister quand j’ai compris que le cercueil allait disparaître par une trappe pour se retrouver dans le four. Je ne sais pas ce qui m’a pris. Je serais incapable de me souvenir de mes gestes et de mes mots exacts. Je me suis levé, bouleversé,indigné, et j’ai dit « On ne peut pas le laisser partir comme cela ! J’ai posé une dernière fois la main sur le cercueil en balbutiant un « Merci » ou un « Au revoir ».
C’est vers cette période – un psychanalyste dirait que tout est lié – que j’ai perdu mes illusions politiques. Même après la chute du mur de Berlin, même après l’effondrement des régimes communistes, je restais persuadé que la révolution était possible. Simplement on s’y était mal pris,on avait eu tort d’employer la violence, on avait récolté la violence. On avait recréé des classes sociales. Mais un jour,c’était sûr, il existerait une société plus juste, plus libre,plus fraternelle. L’écrivain que j’étais l’avait certifié dans un livre au titre volontariste qui n’avait trompé personne : « Les partageux ne meurent jamais ».
Je continuais à me lever chaque matin, à lacer mes chaussures, en me disant que j’allais œuvrer, pas seul bien sûr, mais avec des millions d’autres, à l’avènement de cette société paradisiaque. C’est ce mot de « paradisiaque » que je me suis surpris à prononcer qui a commencé à semer le doute dans mon esprit. Je n’étais pas croyant, mais je me suis rendu compte que j’avais une foi quasi religieuse en la révolution. Je n’espérais pas en un paradis céleste, mais en un paradis terrestre qui lui ressemblait singulièrement.En fait, je poursuivais l’éternelle et insaisissable utopie qui depuis toujours taraude les hommes qui veulent donner un sens à la vie.
Une interrogation sacrilège et désespérante se glissait peu à peu en moi : la tâche à laquelle j’avais consacré l’essentiel de ma vie, depuis mon adolescence influencée justement par mon père, n’était-elle pas irrémédiablement vaine ? Pour changer la société injuste dans laquelle nous vivions, il fallait d’abord changer les êtres humains qui la composaient. Or, ces êtres humains n’avaient guère l’intention, ni surtout la possibilité, de changer. Ils se contentaient de mettre en œuvre leur nature humaine de toujours. J’étais allé en Yougoslavie, j’avais été effaré devoir comment des gens apparemment civilisés pouvaient sombrer dans la barbarie la plus complète et se massacre rentre voisins.
Jusque-là, je pensais que la société progressait. Avec certes de terribles retours en arrière, des dents de scie qui mordaient profondément dans la chair des hommes. Mais elle progressait. À présent, je n’en étais plus très sûr. Ma représentation géométrique de ce progrès était une ligne qui montait vers le ciel. Je voyais maintenant un cercle qui tournait sur lui-même, sans se déplacer d’un centimètre.
Quand je me penchais sur les actions que j’avais menées, je me posais des questions : avaient-elles été bénéfiques ou nuisibles ? Comme beaucoup de militants j’avais soutenu des luttes de libération, l’Algérie, le Vietnam, Cuba, qui avaient débouché sur des dictatures aussi critiquables que le régime précédent. Je me demandais si on avait le droit d’agir lorsqu’on était incapable de prévoir les résultats de son action à moyen et à long terme. N’était-ce pas tout simplement de l’irresponsabilité ? Et moi, l’intellectuel de gauche à la bonne conscience, je remettais en cause la quinzaine de livres que j’avais écrits, mes défenses d’avocat spécialisé dans les droits de l’homme, mes interventions, mes délégations à l’étranger. Ma vie. Brutalement, c’était comme si je n’avais rien fait de cette existence. Elle était creuse, elle n’avait fait que tourner elle aussi sur elle-même. Je gardais l’envie d’aider les autres, j’en voyais la nécessité, mais je me posais tant de questions, j’avais tant de scrupules, que je me retenais d’agir pour ne pas risquer de porter tort à ceux que je voulais aider.
Il arrivait qu’on me parlât avec chaleur d’un de mes livres ou d’une action à laquelle j’avais participé. J’éprouvais beaucoup de difficultés à me dire que j’en étais l’auteur. Je n’avais plus de passé. Un grand trou derrière moi et sous mes pieds un sol guère plus solide.
Restait l’amour. Même pas. Ma compagne de longtemps, je me rendais compte que je l’avais choisie et aimée parce qu’elle était une complice de combat, parce qu’à deux on abat plus de besogne, on est plus efficace. Le combat entouré de sentiments est toujours plus attrayant. Maintenant, faute d’actions communes, je m’ennuyais avec elle. De plus, elle comprenait mal ma nouvelle attitude. Avec son aide, j’étais parvenu à me bâtir une certaine notoriété dans le milieu militant des droits de l’homme,j’y étais plutôt estimé. Aujourd’hui, je faisais en sorte de démolir cette notoriété. Je refusais tout, les émissions de télévision et de radio, les conférences, même les signatures de pétitions qui ne demandent aucun effort. Je n’aspirais qu’à une chose : me mettre à l’écart dans la verdure, pour réfléchir, mais surtout me reconstruire. Ma compagne, elle, ne jurait que par la ville, et par Paris où elle avait toujours vécu. Elle trouvait aberrant de consacrer l’essentiel de nos maigres économies à acheter une petite maison dans un trou perdu où il ne se passerait rien d’intéressant.
Un jour, l’ennui et le désaccord me sont apparus trop importants, j’ai décidé de partir.
Pas de partir pour des vacances au bord de la mer ou à la campagne dans la fameuse petite maison. Me retirer, disparaître en quelque sorte, si possible loin, en changeant totalement de vie. Je pensais qu’éloigné de ce que j’avais jusqu’ici vécu, je pourrais peut-être rebâtir autre chose et d’abord moi-même, donner un sens à la dernière partie de mon existence.
J’étais prêt à n’importe quelle proposition, même la plus extravagante. On ne me proposait que de continuer ce que j’avais fait jusqu’ici, c’est-à-dire des actions militantes. J’expliquais que je cherchais autre chose, sans bien savoir quoi. On ne me comprenait pas, dans le pire des cas on me considérait comme un lâcheur qui, comme tant d’autres, renonçait à la lutte.
J’ai fini par comprendre que je n’avais plus qu’un allié : le hasard. Si je voulais continuer à vivre, j’étais obligé de m’en remettre totalement à lui. Il était le seul terrain à peu près solide sur lequel je pouvais m’appuyer.
- Articles et émissions concernant Le Déplacé
- Liban 1998 - Photos
- Premiers chapitres
- Chapitre 1
- Chapitre 2
- Chapitre 3
- Chapitre 4
- Documents concernant Le Déplacé
- Témoignage du Père Samih Raad, ancien curé de Maasser-el-Chouf (22 février 2012)
- Témoignage d’Élias Chakar, chrétien rescapé du massacre de Maasser-ech-Chouf.
- La guerre est-elle inhérente à la nature humaine ? (Guerre du Liban)
- Photos Beyrouth 2012
- Salon du Livre francophone de Beyrouth 2012
- Le Voyage de Nerval (Gérard de Nerval au Liban)
- Liban. Le Déplacé et Le Voyage de Nerval